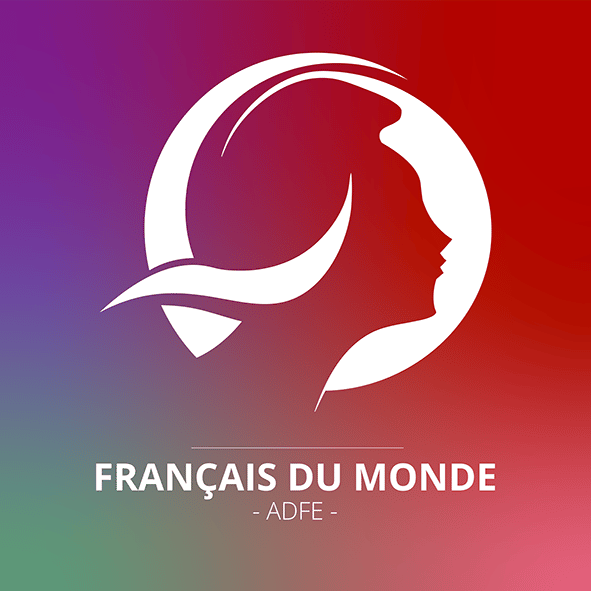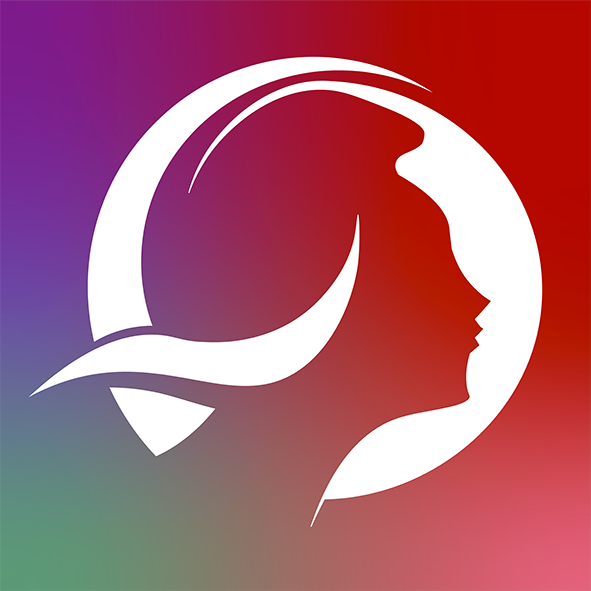La question et son énoncé soulèvent plusieurs questions. Honorer la mémoire des anciens combattants de la colonie de Côte d’Ivoire, citoyens ivoiriens depuis le 7 août 1960, qui se sont battus sur des théâtres d’opération où la France était impliquée, n’est donc pas si évidente ? La réponse est oui, évidemment, nous leur devons ce devoir de mémoire, mais elle mérite des développements.
L’Association fraternelle des anciens combattants de Côte d’Ivoire (AFACCI) regroupe 56 membres, il y en a certainement de nombreux autres qui ne se sont pas déclarés. La question en titre ce cet article a-t-elle, elle-même, un sens si on considère qu’elle concerne peu de personnes, dont le nombre diminue d’années en années ? Nous devons ce travail de mémoire moins pour eux que pour les générations ivoiriennes qui viennent. C’est la fonction des commémorations : faire mémoire ensemble pour que la communauté n’oublie pas.
La question qui suit est plus difficile. Que l’on honore des anciens, c’est normal, mais si c’est la mémoire de ce qu’ils ont fait qu’il faut préserver, alors pourquoi les Ivoiriens devraient-ils commémorer des combattants qui se sont battus pour l’ancienne puissance coloniale ? Parce qu’ils sont Ivoiriens et qu’ils participent de la mémoire partagée de tous les Ivoiriens et ivoiriennes : ils sont mariés, ils ont des frères, des sœurs, des enfants et des petits enfants, leur histoire infuse encore aujourd’hui dans beaucoup d’histoires familiales ivoiriennes.
Les mémoires tronquées de l’histoire
Les derniers anciens combattants de la première guerre mondiale nous ont quittés au tout début des années 2000. Ceux de la seconde guerre récemment. Tirailleurs du réalisateur Mathieu Vadepied avec Omar Sy a été le premier film français au box-office en 2023 avec 1 300 000 d’entrées. Il a été visionné à Abidjan en janvier 2023 et a fait salle comble à l’Institut Français. Il raconte l’histoire en 1915 d’un père qui s’engage comme tirailleur sénégalais pour retrouver son fils enrôlé de force sur les terribles champs de bataille de la première guerre mondiale. Entre 1914 et 1918, parmi les 200 000 tirailleurs sénégalais de la « Force Noire » du général Mangin envoyés au combat, on estime que 23 000 venaient de la colonie de Côte d’Ivoire. 8500 ne revinrent pas, tués et disparus. C’est la proportion de toutes les unités montées au front. « Après cette bataille, vous ne serez plus des indigènes, vous serez des français ! ». leur dit un général au Chemin des Dames. Cette promesse ne fut bien sûr pas tenue, pire ils durent attendre 2006 après le film Indigènes qui fit 3 millions d’entrées et qui raconte l’amitié de quatre tirailleurs Algériens pendant la seconde guerre mondiale, pour que le Président Chirac demande que le montant de leurs pensions bloqué depuis le 7 août 1960, soit valorisé au même niveau que leurs frères de combat. A la sortie du film Tirailleurs le Président Macron a levé la contrainte faite aux pensionnés militaires de résider six mois en France pour percevoir le minimum vieillesse. Des mesures tardives, dérisoires, vu le nombre de militaires concernés et les montants en jeu, dira-ton. Certes, mais la question est de savoir pourquoi des films grand-publics, plutôt convenus, portés par des acteurs connus, plus que par une réalisation originale, ont eu un impact tel qu’un Président de la République se soit senti obligé de poser un acte officiel au moment de leur sortie, comme s’il fallait réparer quelque chose, réajuster nos mémoires partagées avec les Africains, voire rapiécer la mémoire officielle mitée de la France.
Les amnésies de l’histoire
Ceux qui sont encore avec nous se sont battus en Afrique du Nord et en Indochine dans les guerres coloniales que la France a menées pour perpétuer un ordre mondial dépassé. C’est là qu’une dernière question peut se poser : faut il honorer la mémoire de combattants qui ont participé aux guerres contre des Africains qui luttaient pour leur indépendance ? Les premiers coups d’Etat en Afrique francophone vinrent de ces ancien combattants : Eyadema au Togo, Traore au Mali ou Bokassa en Centrafrique. Le décès d’Odile Vasselot en avril dernier, ancienne résistante, pionnière de l’éducation des jeunes filles en Côte d’Ivoire nous avait permis d’aborder la question des mémoires partagées entre les Ivoiriens et la communauté française dans le pays, mais son double combat pour l’égalité et la liberté de notre devise républicaine ne soulevait aucune question de légitimité.
Pour Paul Ricoeur[1] la notion de mémoire collective était un leurre. Selon lui, la mémoire est une capacité individuelle. La porter à un niveau collectif n’avait pas de sens d’un point de vue scientifique, elle était au mieux une métaphore. Il préférait la notion de mémoires partagées où l’historien a un rôle central pour documenter toutes les vérités de l’histoire, y compris ses parts d’ombres que nous avons du mal à regarder. On pense à Thiaroye au Sénégal quand le 1er décembre 1944 un grand nombre de tirailleurs africains de retour après les combats de la seconde guerre mondiale qui s’étaient mutinés pour réclamer leur solde avaient été massacrés à la mitrailleuse par les gendarmes français. En 2014 le Président Hollande admit que le nombre de morts était « probablement » de 70 au lieu des 35 « mutins tués » officiels. Mais, malgré ses promesses, l’accès aux archives militaires complètes de ce dramatique évènement est encore impossible aux historiens qui estiment le nombre de tués à 200 voire 300. En 2025 on parle encore de « massacre » et les autorités sénégalaises demandent toujours l’ouverture complète des archives de qui fut un crime de guerre coloniale, organisé, voire prémédité, camouflé par les autorités militaires françaises et couvert jusqu’à aujourd’hui par les autorités politiques.
On se souvient du roi des Abrons Kouadio Adjoumane, son fils Kouamé Adringa et plusieurs milliers de guerriers, qui quittèrent la Côte d’Ivoire pour participer aux combats de la France Libre, depuis le serment de Koufra au Tchad jusqu’à la libération de Strasbourg le 23 novembre 1944, en passant par Tunis, Palerme, Monte Cassino, Rome, la Provence et Paris. Mais qui accepte de regarder les mémoires partagées des descendants des Italiennes victimes des exactions des tirailleurs sénégalais et Algériens qui formaient le gros des effectifs de l’armée du général Juin en Italie en 1943 ? Ces mémoires sont encore imprégnées du souvenir des crimes commis par les soldats qui combattaient sous le drapeau français. De la même manière, le rôle central des troupes coloniales africaines dans la conquête de Madagascar au tournant des années 1900 est documenté[2]. La participation importante des troupes venues d’Afrique dans l’occupation de la Ruhr en 1920 a eu pour conséquence qu’en 1940, les troupes nazies victorieuses voudront se venger au nom de la race et ne se retiendront pas pour arrêter, torturer et exécuter les tirailleurs qui s’étaient battus durement dans les combats de 1940. Jean Moulin jeune préfet d’Eure-et-Loir racontera l’ampleur de ces exécutions dont il fut l’un des témoins impuissants quand des soldats du 26e régiment de tirailleurs sénégalais furent assassinés.
[1] Paul Ricoeur. La mémoire, l’histoire, l’oubli. Seuil 2000.
[2] Lyautey. Lettres du Tonkin et de Madagascar. Armand Colin. 1920
Vérité de l’histoire
Dire la vérité de l’histoire ne veut pas toujours dire la reconnaître officiellement. Tous les historiens qui documentent les faits historiques le savent. Alors que commémorons nous, autour de quoi faisons nous mémoire collectivement, autour de ces derniers combattants ?. Ne serait-ce pas le troisième volet de notre devise républicaine, celui arrivé en dernier avec l’éphémère seconde république : La fraternité ? La fraternité des armes, celle des combats menés ensemble malgré les contradictions et les impasses des engagements, en définitive, celle du lien nécessaire pour faire société. La fraternité du triptyque français n’est pas éloignée de l’union de celui de la Côte d’Ivoire. Ces mémoires partagées et leurs souffrances sont comme un plus grand dénominateur commun mémoriel qui structure notre volonté de vivre ensemble au-delà des espaces nationaux. Les anciens combattants que nous commémorons sont des personnages à hauteur d’humanité auxquels nous pouvons nous identifier quelque soit le contexte. S’ils n’étaient pas du bon côté de l’histoire dans les guerres coloniales qu’ils ont perdues, ils étaient aussi les victimes d’un ordre de domination imposé par la France. Eux seuls connaissent la vérité des actes qu’ils ont commis ou auxquels ils ont participé. En France notre travail d’anamnèse sur la colonisation ne fait que commencer, il aboutira à terme à la reconnaissance de la colonisation comme crime contre l’humanité et, à leur corps défendant, les anciens combattants de Côte d’Ivoire auront contribué à cette reconnaissance. En Côte d’Ivoire dont l’histoire nationale est plus récente, les travaux de mémoire avaient débuté avec la Commission Dialogue Vérité et Réconciliation, mise en place en 2011 après la guerre civile avait tenté d’avancer dans ce chemin de vérité mémoriel. Il est toujours largement ouvert.