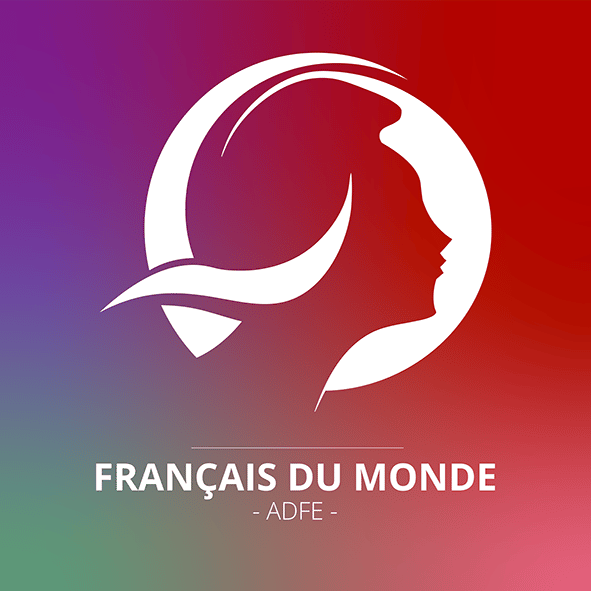La première partie de ce témoignage avait été publiée ici.
Pour un pays comme l’Equateur, il est nécessaire dans un premier temps de reconnaitre une culture propre, qui ne soit ni une pâle copie de modèles européens ni une « folklorisation » qui enferment les individus dans une représentation liée essentiellement à leur groupe ethnique de provenance. La création du ministère de la Culture ainsi que la réaffirmation de ces principes dans la Constitution de 2008 sont la preuve d’une volonté politique qui place l’auto estime et la souveraineté nationale, non seulement dans les faits, mais aussi dans le champ du symbolique et de l’imaginaire collectif. Cette mise en valeur de la diversité culturelle rend inévitable l’établissement d´une véritable interculturalité dans une société postcoloniale où le « nous » est malaisé à exprimer. La difficulté supplémentaire, au-delà de mécanismes inclusifs, est bien la représentation que chacun se fait de sa propre culture, dans cette relation souvent viscérale que nous entretenons tous avec l´image de qui nous sommes comme membres d’une communauté nationale. La vision essentialiste, qui génère forcément stéréotypes, de chaque identité propre (l’autre est LA différence, face au Je) se trouve donc renforcée à la fois parce qu’il s’agit d’un pays où l’identité est en dispute (on entend « interculturalité » comme la tolérance à une différence qui n´est pas moi) et de surcroît dans ce cas, exposée au regard des autres. L’exemple le plus typique de l’Amérique andine étant la Fête nationale dans les missions diplomatiques durant laquelle l’ambassadeur métis-blanc prononce son discours avant que les artistes, indiens ou noirs, chantent et dansent….
Dans ce contexte, mon identité d’étrangère m’a fourni la distance nécessaire pour discerner la qualité artistique et la réception dans le pays d’accueil. Il est intéressant aussi de noter que dans le cadre de l’organisation à l’étranger d’événements culturels, nous nous proposions d’obtenir les conditions promises au bon déroulement des activités ; or en cas de problème, racismes et préjugés se réactivaient rapidement (même et surtout sur le continent) pour finalement se dissoudre face à la déconcertante situation d’une représentante officielle d’artistes équatoriens au physique, nom et accent différents. De même dans les espaces multilatéraux, être la voix dans un collectif qui aspire fortement à l´intégration latino-américaine et à la coopération sud-sud, trouve sa légitimité dans le fait qu’il s’agit bien là de l´expression d’une résolution et d’une construction politiques.
Ma participation s’est parfois vue limitée par un sentiment d’irréalité à représenter une identité avec laquelle je n´ai rien en commun, et dans le domaine des relations internationales, un désaccord avec la politique étrangère du pays, sentiment certainement connu par tous les diplomates. Le bilan est clairement positif : les qualités « françaises » dues à mon parcours ont trouvé un cadre parfait dans lequel s’épanouir, c’est-à-dire un pays où il reste beaucoup à faire. L’interface est une expertise d’avenir quand elle s’appuie sur une bonne formation, une empathie (facilitée par l’absence de passé colonial commun) car elle met en valeur les capacités du pays dont on provient au service de celui auquel on contribue dans l’intérêt général. Comme me disaient des collègues lors d´un atelier dans un lycée où j’étais enseignante de français langue étrangère : « Tu es à la fois si française et si intégrée ». Il ne reste plus à souhaiter, à nous souhaiter que les postes diplomatiques et les institutions françaises hors frontières valorisent ces acquis. Je conclurais par la définition d´Ambroise Bierce, dans son très caustique Dictionnaire du Diable : « Exilé : Personne qui sert son pays en résidant à l’étranger, sans être pour autant ambassadeur ».
Florence Baillon
Quito, 4 juin 2013