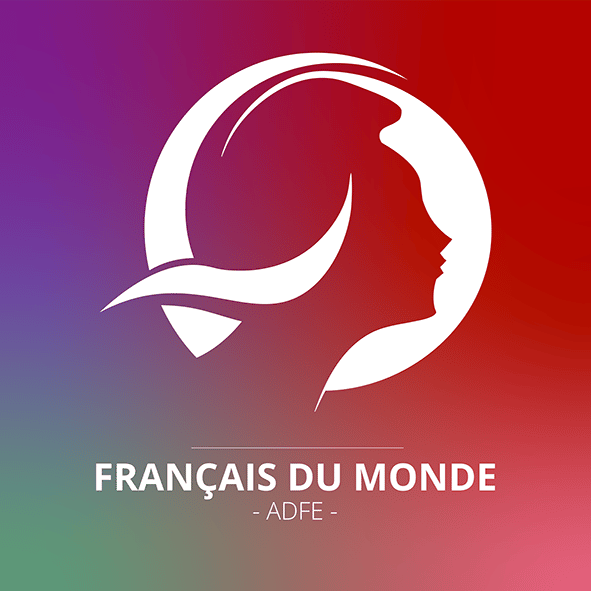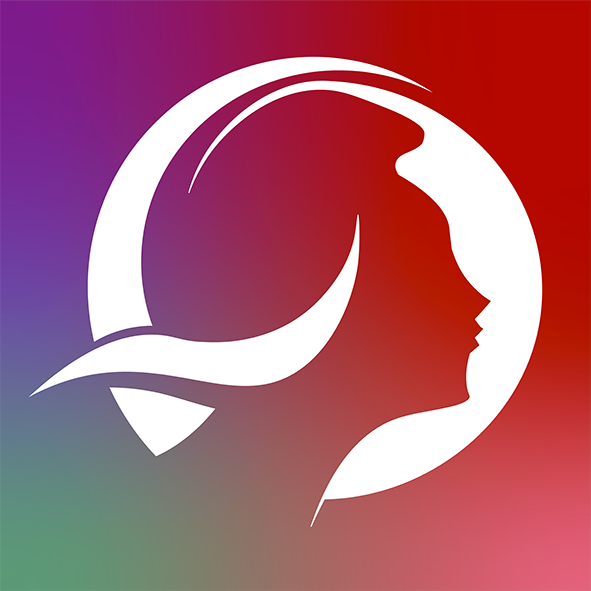Dans le cadre de son projet STAFE, Français du monde – Munich a accueilli la juriste Julia Grignon à l’institut français de Munich le jeudi 23 octobre 2025 pour sa conférence « Conflits armés, zones de non-droit ».
De renommée internationale Julia Grignon s’intéresse à toutes les branches du droit international relatives à la protection de la personne, mais son domaine de spécialisation et de recherche est le droit international humanitaire et sera le fil rouge de sa conférence.
Dès sa première prise de parole elle exprime son besoin d’aller vers le public, pour le sensibiliser au droit international humanitaire, chacun pouvant jouer un rôle pour le faire respecter. Ce soir-là elle apprécie l’échange avec les auditeurs français de Munich.
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, les conflits armés sont soumis à des règles strictes, fixées par les quatre Conventions de Genève adoptées en 1949, en réponse aux violences perpétrées pendant la Seconde guerre mondiale et en soutien aux prisonniers de guerre, règles malheureusement très peu respectées. Ces conventions, signées et adoptées par tous les pays, ont été maintes fois revues et complétées : en 1954 s’y ajoute la protection des biens culturels, en 1977 celle des personnes plus vulnérables, notamment des enfants, grâce aux Protocoles additionnels, et en 2002 la création de la Cour pénale internationale. Elles interdisent l’utilisation de certaines armes, les bombardements de sites non stratégiques et punissent les violations également après les conflits.
Henri Dunant posa les bases de la convention de Genève, en 1864, après avoir constaté les atrocités de la bataille de Solférino sur les combattants comme sur les civils, en insistant sur la neutralité et l’impartialité comme principes de base devant régir les secours et les soins à leur prodiguer. Le CICR (Comité International de la Croix Rouge), créé dans la foulée et présent dans tous les conflits armés, peine cependant à y imposer le droit humanitaire.
Dès l’antiquité les combats ont été gérés par des règles. La charte des Nations-Unies établie dès 1945 souligne la résolution des conflits par tout autre moyen que la guerre et le respect des droits de chacun. La règle de proportionnalité, le droit à l’aide humanitaire et les droits des personnes sont malheureusement très souvent bafoués lors des combats, le Tigré, l’Ukraine, le Rwanda, le Soudan, l’ex-Yougoslavie, Gaza en sont de piteux exemples.
Ces violations peuvent être portées devant la Cour pénale internationale (CPI), instituée en 2002 après la signature du Statut de Rome en 1998. Elles doivent être documentées, avec justesse et précision pour avoir une chance d’aboutir, un processus long et hypothétique.
Quelques cas de respect de ce droit humanitaire international, quoique difficiles à contrôler pour cause de confidentialité, et des succès du droit pénal comme le procès de Milosevic, bien qu’interrompu par son décès, sont à noter. L’information des forces armées et des populations touchées y contribuent, mais ne sont pas reliées par les réseaux sociaux qui préfèrent propager les cas de non-respect.
Cette deuxième conférence s’est révélée passionnante par sa richesse d’informations sur le droit international humanitaire et pénal, leurs règles et leurs limites, et par l’enthousiasme de Julia à nous les communiquer et à engager un dialogue vivant avec les participants, notamment sur les conflits actuels.
Le cycle de conférences de Français du Monde – Munich se terminera le 27 novembre avec Maxime Blondeau, cosmographe, qui proposera « un nouveau regard sur le territoire ».