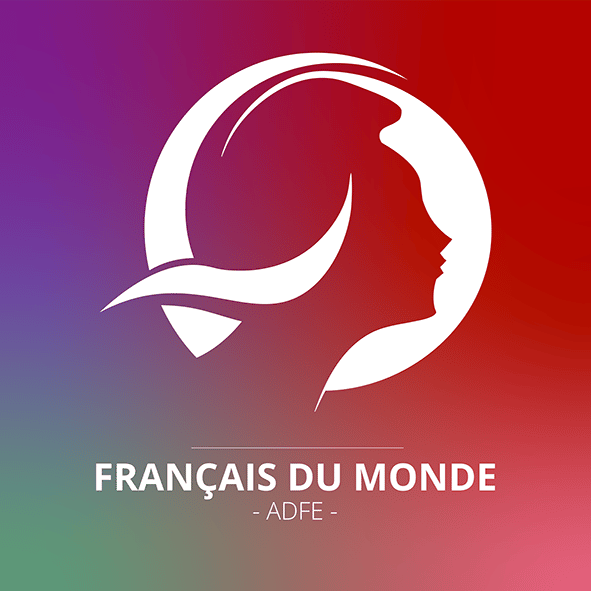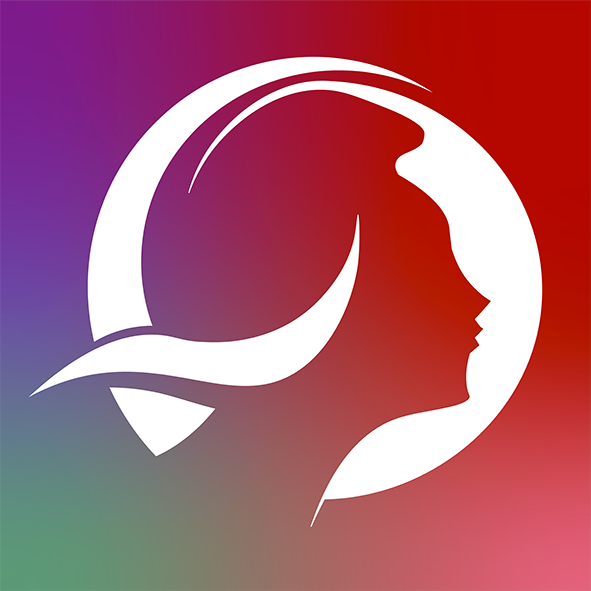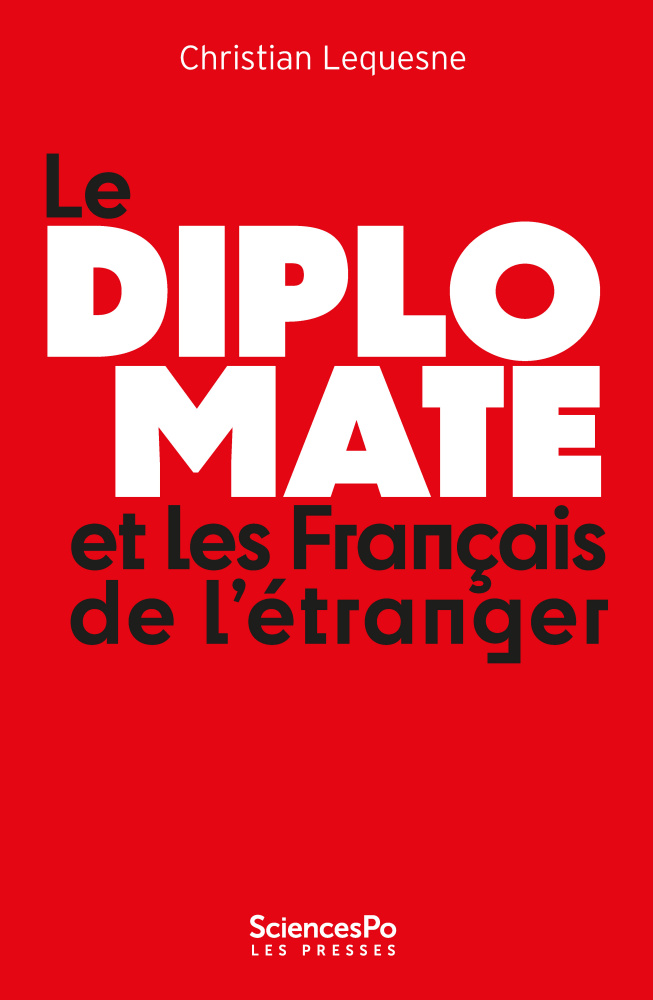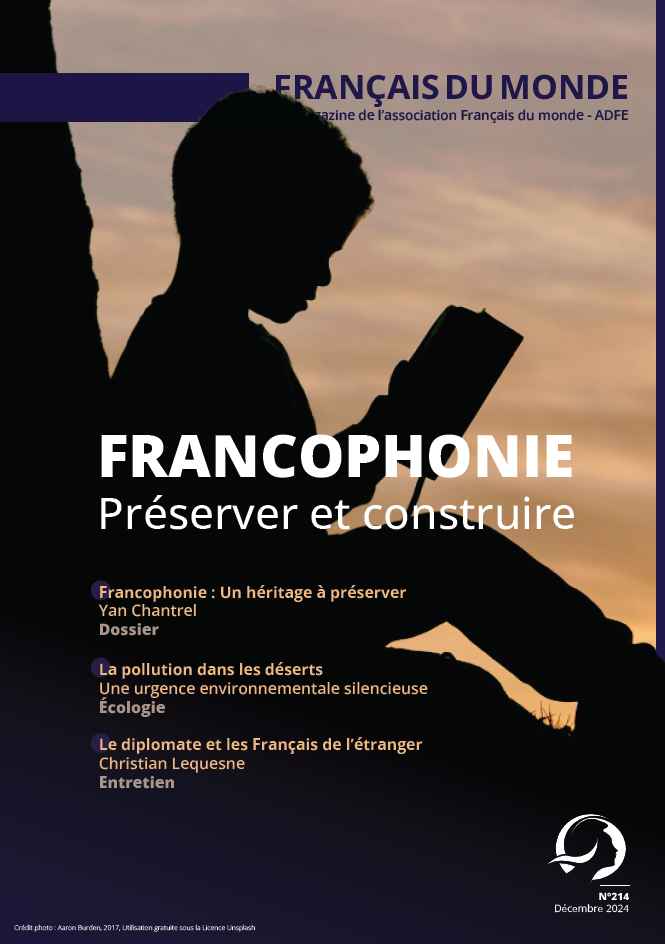À l’occasion de la parution de son ouvrage Le diplomate et les Français de l’étranger (Presses de Sciences Po), Français du Monde a rencontré Christian Lequesne, professeur à Sciences Po Paris et ancien directeur du Centre d’études et de recherches internationales (CERI). Dans cet entretien, il revient sur le travail préparatoire à son livre, son analyse des relations entre la France et ses ressortissants, et sur le rôle de la diplomatie “consulaire” et “de diaspora”. À travers ses recherches, il interroge la manière dont l’État français construit et maintient un lien avec ses citoyens vivant hors de France.
Un travail d’enquête pour un état des lieux
Vanessa Gondouin-Haustein : Monsieur Lequesne, comment qualifieriez-vous cet ouvrage ? S’agissait-il d’une enquête, d’une étude, ou d’un état des lieux ?
Christian Lequesne : Pour moi, il s’agissait avant tout d’un état des lieux. Toutefois, je suis tout à fait d’accord pour parler d’enquête, car les trois années précédant la rédaction de ce livre ont véritablement constitué une enquête approfondie. Je suis un chercheur qui a toujours besoin de partir du terrain. C’est la rencontre des acteurs qui vient ensuite inspirer ma réflexion plus générale. J’ai toujours procédé ainsi pour l’écriture de mes livres.
Stéphane Arnoux : Quel était l’objectif principal de votre travail et à quel type de public le destinez-vous ?
CL : L’objectif de mon ouvrage découle des recherches que je mène depuis une dizaine d’années sur la diplomatie. À Sciences Po, j’ai développé un programme sur la diplomatie envisagée comme une pratique, un domaine peu étudié en France mais déjà structuré dans d’autres pays, comme en Europe du Nord ou en Amérique du Nord. Ce qui m’intéresse particulièrement, c’est de comprendre comment la diplomatie se construit concrètement, au travers des pratiques des professionnels du métier. En 2017, j’ai publié Ethnographie du Quai d’Orsay (CNRS éditions), basé sur une enquête où j’ai combiné observation au sein du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et entretiens en administration centrale et dans plusieurs ambassades. Ce travail m’a permis de noter une lacune importante dans la recherche : les questions étaient rarement consulaires abordées par les spécialistes des études diplomatiques, alors qu’elles représentent un volet essentiel de l’action diplomatique française, notamment en matière de protection et de suivi des ressortissants vivant à l’étranger. Cette prise de conscience m’a conduit à approfondir le sujet, en analysant comment l’État en France, à travers ses institutions, investit la relation avec ses ressortissants : bourses pour les enfants scolarisés, assistance sociale, bureaux pour l’emploi, etc. J’ai aussi constaté que cette action reflète une culture étatique spécifique qui s’inscrit souvent dans des trajectoires historiques de temps long.
Ce travail s’adresse à un public varié : universitaires, étudiants en relations internationales, mais aussi responsables politiques et administratifs, ainsi qu’à tous les Français de l’étranger, qui peuvent y trouver une meilleure compréhension des interactions entre l’État français et sa « diaspora ». Il ne s’agit pas d’une étude sur les flux migratoires, mais d’une réflexion sur la manière dont l’État construit une pratique relationnelle avec ses nationaux à l’étranger, pour maintenir un lien fort et durable.
Le choix de la « diaspora » : un terme qui bouscule les conventions
SA : Vous employez le terme « diaspora » pour désigner les Français de l’étranger, un mot rarement employé dans le discours officiel. Pourquoi ce choix, et en quoi ce terme reflète t-il mieux la réalité des Français établis hors de France, par rapport à des expressions comme « communauté » ou « expatriés » ?
CL : En France, le terme « diaspora » est effectivement plus souvent réservé aux populations immigrées vivant sur le territoire, comme on le fait pour parler des diasporas sri-lankaises, sénégalaises ou marocaines. Mais nous avons une certaine réticence à nous l’appliquer à nous-mêmes. Cela reflète, je crois, une difficulté à reconnaître que l’on peut aussi émigrer en tant que Français. Cette réserve est liée, en partie, à une forme de psychologie collective mais aussi à notre conception très unitariste de la citoyenneté française.
Dans cette conception, parler de « diaspora française » pourrait être perçu comme validant une forme de communautarisme, une entité distincte qui irait à l’encontre de notre idéal d’unité républicaine. Ce réflexe s’enracine peut-être dans notre histoire coloniale, où les Français établis hors de France étaient vus comme des citoyens à part entière, extériorisés mais jamais considérés comme un groupe spécifique. Ce choix de terminologie me semble pourtant pertinent, car il permet de reconnaître la diversité et la complexité des expériences vécues par les Français à l’étranger. Le terme « diaspora » reflète une réalité de liens transnationaux, de pratiques culturelles et sociales partagées, tout en reconnaissant les spécificités du vécu en dehors des frontières. Cela dit, cette réflexion reste intuitive et mériterait d’être approfondie davantage, notamment avec les collègues historiens.
Le système de représentation des Français de l’étranger
SA : Dans quelle mesure le système de représentation en France se distingue-t-il de celui des autres pays, et quel impact cela a-t-il sur leur influence politique ?
CL : Prenez l’exemple de l’Assemblée des Français de l’Étranger (AFE) : cela n’a pas d’équivalent dans d’autres pays. En France, nous avons un système très institutionnalisé, avec des budgets dédiés à l’organisation des sessions de l’AFE à Paris, bien que les indemnités des membres ne soient pas très élevées. Ces initiatives sont soutenues par des ressources d’Etat, et même si les représentants de l’AFE peuvent parfois devoir mettre un peu de leur poche pour financer leur hôtel à Paris, cela reste un modèle soutenu par l’Etat.
En France, vous avez aussi une représentation parlementaire spécifique pour les Français de l’étranger. Le système est complexe, avec des sénateurs sans circonscription spécifique et des députés élus dans des circonscriptions immenses. Ce modèle de représentation est bien la preuve que l’Etat organise les canaux d’influence des Français de l’étranger dans les débats nationaux.
La volonté de faire revenir les Français de l’étranger
SA : Vous citez des propos de Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron sur la volonté de faire revenir les Français de l’étranger. Pourquoi, selon vous, cette stratégie politique de vouloir maintenir un lien fort ou inciter au retour en France ? Qu’est-ce qui motive cet axe de réflexion ?
CL : Cette stratégie est liée à la nature de l’émigration actuelle. Si l’on examine leurs profils contemporains d’émigration française, particulièrement en 2024, il s’agit majoritairement de personnes qualifiées : des diplômés Bac+2, Bac+5, et plus. Cette fuite des talents est souvent perçue comme un symptôme de malaise. Elle soulève des questions importantes sur le travail en France que nous peinons à aborder franchement : montant des salaires nets, relations hiérarchiques, rigidité d’un système normé par la nature du diplôme. À cela s’ajoutent des dynamiques sociales spécifiques. Par exemple, des études menées par des sociologues spécialistes des migrations à Lille montrent qu’une proportion significative des jeunes diplômés qui partent sont issus de l’immigration. Ils choisissent parfois de partir pour échapper à certaines contraintes propres à la France, notamment liées à une conception stricte de la laïcité.
Il y a l’expression, dans les discours politiques des présidents, que ces départs représentent une perte, notamment lorsque ces talents partent vers des écosystèmes comme la Silicon Valley, perçus comme des opportunités manquées pour la France. C’est un phénomène européen plus large, mais en France on en parle toujours avec regret et non comme une chance. D’où le discours officiel sur le retour.
La reconnaissance des expériences à l’étranger
SA : Dans votre ouvrage, vous évoquez les difficultés que rencontrent certains Français à valoriser leur expérience acquise à l’étranger lorsqu’ils reviennent en France, en citant notamment un rapport de la sénatrice Hélène Conway-Mouret. Pouvez-vous expliquer pourquoi ce phénomène persiste ?
CL : Ce problème n’est pas spécifique à la France mais touche de nombreux pays occidentaux. Lorsqu’on parle d’expatriation stricto sensu, il s’agit d’une mobilité temporaire, avec un projet de retour au pays. Ce retour est rarement simple ou accueilli avec enthousiasme. Au contraire, il s’accompagne souvent de frustrations pour ces personnes, qui espéraient voir leurs expériences internationales reconnues et valorisées.
En France, par exemple, il existe des obstacles institutionnels. Je cite le cas du Conseil national des universités (CNU) dans ma discipline, la science politique : des candidats ayant travaillé à l’étranger et publié dans des revues internationales se sont vus parfois refuser la qualification aux postes de maitre de conférences pour n’avoir pas publié en français. C’est évidemment une aberration, car publier en anglais est devenue nécessaire pour accéder à une reconnaissance de la communauté scientifique internationale.
Ces barrières, parfois implicites, traduisent une certaine résistance au changement de la part de corps professionnels qui n’aiment pas l’idée que l’expérience à l’étranger déstabilise les critères de recrutement. Dans une réunion, une sociologue française appartenant à un grand organisme de recherche bien connu disait un jour à propos du recrutement de collègues venant de l’étranger : « Les étrangers, ça craint ! ». Elle ne disait pas cela parce qu’elle était raciste ou xénophobe. Ce qu’elle voulait dire, c’est que des profils extérieurs bouleversaient les codes du compromis auxquels les membres de la corporation sont habitués. Il reste en France des marchés du travail protégés par des critères strictement domestiques. Cette situation aboutit à un faible appétit de valorisation des compétences et des expériences acquises à l’étranger, alors qu’elles devraient constituer un atout majeur pour la France, notamment dans le monde universitaire.
Un modèle français unique mais perfectible
VG : Comment analysez-vous le lien qu’entretient la France avec ses Français de l’étranger ?
CL : Le lien entre les Français de l’étranger et l’État français repose en grande partie sur la protection étatique, un aspect essentiel de la culture politique française. Cette volonté de maintenir un système d’État-providence, même pour ceux qui vivent à l’étranger, fait partie intégrante de l’identité politique de la France. Contrairement à des pays comme le Royaume-Uni ou le Canada, la France n’a jamais connu de révolution néolibérale où le marché serait venu se substituer à l’Etat. Bien sûr, il y a eu des tentatives pour introduire des recettes néolibérales dans l’administration, mais les effets sont franchement restés marginaux.
Les Français de l’étranger continuent à vivre la protection de l’Etat-providence à l’étranger, via les bourses scolaires, les dispositifs STAFE, les mesures d’assistance sociale. C’est un système très particulier, surtout lorsque l’on sait que les aides s’appliquent à des citoyens qui ne payent plus d’impôts en France. Les Français de l’étranger doivent être conscients que ce modèle tient parce que le modèle de l’Etat-providence continue à fonctionner en France malgré la dette publique qui se creuse (120% du PIB contre 60% en Allemagne). Ce modèle cependant s’arrêtera si l’Etat français est un jour en cessation de paiement. Il faudra dans ce cas repenser la solidarité à partir d’autres sources que celles de l’Etat.
Le diplomate et les Français de l’étranger
Comprendre les pratiques de l’État envers sa diaspora
Éditeur Presses de Sciences Po
Auteur Christian Lequesne
Collection Académique
Propos recueillis par
Cet article est extrait du 214e numéro de Français du Monde : « Francophonie : préserver et construire », disponible gratuitement dans la rubrique « Magazine » du site Internet.
Soutenez-nous !
Si vous appréciez ce magazine gratuit et souhaitez soutenir notre travail, vous pouvez nous aider en faisant un don. Les dons aux associations reconnues d’utilité publique, comme la nôtre, permettent de bénéficier d’une réduction d’impôt de 66 % du montant total des versements pour les résidents fiscaux en France.