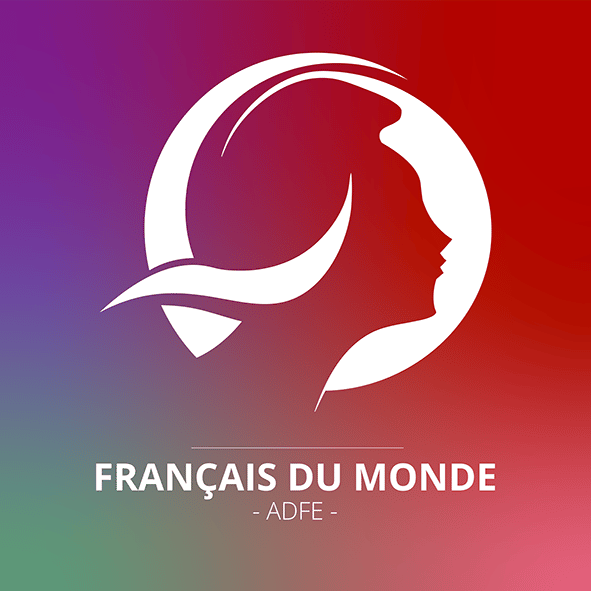Notre association regroupe des personnes engagées, qui donnent de leur temps et de leur énergie pour défendre des valeurs et porter des idées de gauche. Le thème de ce numéro de notre magazine est consacré à l’engagement, et nous avons souhaité réaliser cet entretien avec vous, car vous êtes une figure politique qui, justement, incarne l’engagement. Pouvez-vous nous dire ce que vous-même entendez par ce mot ? Qu’est-ce qu’il vous inspire ?
Je crois que l’engagement succède aux convictions. On construit d’abord des convictions avant de les prolonger par l’engagement. Ce que le mot engagement m’inspire, c’est qu’il est le deuxième étage d’une fusée dans la vie, qui est faite d’abord par la construction de ses convictions, puis par le fait de mettre son propre engagement au service de ces convictions.
Il y a de nombreuses façons de s’engager, et chacun.e de nous peut s’engager d’une manière ou d’une autre : on peut s’engager dans l’art, dans un parcours personnel et dans un rapport aux autres. Pour moi, l’engagement est lié aux autres, on s’engage pour des causes.
En ce qui me concerne, il s’agit de causes qui me dépassent, qui vont au-delà de moi-même. Je ne peux pas m’engager uniquement dans des préoccupations, des champs d’intérêt qui ne se rapportent qu’à moi. Je n’ai pas de talent pour être une artiste, ça structure aussi mes passions.
Donc, l’engagement, c’est les convictions, les causes et la manière dont on les porte, et la manière dont on interagit avec les autres pour défendre ces causes. Ceci tout en sachant que pour moi, dans l’engagement, il y a le mien, bien sûr, mais aussi celui que je vais essayer de susciter chez l’autre pour qu’il s’engage aussi. Certain.e.s diront que l’on peut avoir un rapport à l’engagement qui est beaucoup plus individualiste, plus autocentré que le mien.
En ce qui vous concerne, depuis quand êtes-vous engagée ? Quelles sont les causes qui vous tiennent à cœur ? Ont-elles évolué et/ou au contraire existe-t-il des causes pour lesquelles vous êtes toujours engagée ?
Mon engagement remonte à mon adolescence, il s’est construit dans la découverte de l’injustice et de toutes ses manifestations. Je pense que lorsqu’on a une quinzaine d’années, on a un seuil de tolérance à l’injustice extrêmement bas, et la rébellion contre l’injustice est un vrai moteur d’engagement. Quand on commence à sortir de la sociologie de sa propre famille pour découvrir comment le monde est autour de chez nous, de notre propre vie, on voit, comme moi adolescente, à quel point les injustices structuraient tout mon environnement. L’injustice, c’est le pouvoir du fort sur le faible, c’est le sort réservé aux filles par rapport aux facilités offertes aux garçons, les inégalités sociales que l’on mesure à l’école ; quand on est dans un groupe humain, comme une classe, on constate qu’il y a des inégalités sociales et culturelles. Tout cela me semblait être injustifiable et constituer une raison suffisante pour m’engager. Mon premier ressort, c’est l’injustice.
Et finalement tous vos combats se sont déclinés, de manière différente, autour de cette idée première de l’injustice ?
Spontanément, quand on est contre l’injustice, on est plutôt de gauche, parce qu’historiquement, la lutte contre les injustices et les inégalités sociales est l’un des marqueurs de la gauche. L’engagement à la fois à gauche mais aussi sur des causes avec des engagements multiples : il y a à la fois un engagement global et des engagements multiples, en particulier les questions féministes. Et puis j’ai été amenée à m’engager pour des causes découvertes au fur et à mesure de mon parcours, de mes responsabilités d’élue ou au gouvernement. Par exemple, la protection de l’enfance et les droits de l’enfant sont une cause que j’ai rencontrée tardivement, mais pour laquelle je pense m’être engagée et l’être encore.
Il y a une autre cause qui échappe un peu à la grille de lecture purement justice et injustice, c’est l’écologie. L’écologie, c’est une cause en soi, qui a des conséquences en termes d’injustice et d’inégalité, mais qui est une cause spécifique qui n’est pas fondée sur la lutte contre les injustices. Pour moi, c’est la première en réalité.
Vous êtes sénatrice, en quoi un mandat électif a-t-il changé votre action militante ? Est-ce que le fait d’être élue change l’engagement, dans la forme et dans le fond ?
Être élue, c’est avant tout être un porte-voix, c’est parler d’ailleurs, avec une fonction, une légitimité qui vous a été donnée par les élections, un statut et une fonction dans la République, qui fait de vous une représentante du peuple, ce qui vous permet de parler plus fort, d’être plus respectée dans votre parole. Il y a comme une espèce de légitimation de la parole par la fonction d’élue, qui permet d’être davantage entendue et de disposer de moyens d’expression plus larges. Le principal intérêt d’être parlementaire, c’est que l’on peut prolonger son engagement dans les politiques publiques.
Quel est votre regard sur la pandémie mondiale : en quoi cette situation inédite dévoile-t-elle les limites de l’action politique, celle de l’exécutif, celle des élus, celle des citoyens ?
La première conséquence de la pandémie, c’est qu’elle porte atteinte au sentiment de toute-puissance que l’homme a acquis sur son environnement ; en d’autres termes, depuis les débuts de l’ère industrielle, nous avons vécu dans l’idée que notre capacité à maîtriser et dominer l’ensemble des éléments nous est venue du progrès technologique et que nous sommes en quelque sorte les seuls maîtres sur la planète. Ce sentiment a considérablement affaibli et affecté les écosystèmes dans lesquels l’homme évolue. La première leçon de la pandémie, c’est que cette toute-puissance est renforcée par le pouvoir et la richesse, puisque souvent cela va ensemble : ce sont ceux qui ont le pouvoir et la richesse qui déploient cette toute puissance sur la nature et les écosystèmes, considérant qu’ils peuvent les dominer et se les approprier, se les accaparer pour leur intérêt exclusif. Cette toute-puissance peut aussi se retrouver in fine totalement mise à bas, jetée à terre par une épidémie et ce, de manière planétaire. C’est la première remarque.
La deuxième remarque, je ne dirais pas que c’est la limite de l’action politique parce que justement, l’organisation des sociétés pendant la pandémie, les moyens donnés pour se protéger, pour lutter contre le virus sont liés à la force et la solidité des États et des politiques publiques. Plus un État est fort, et plus il a la capacité d’organiser la protection de ses citoyen.ne.s. A contrario, plus les États sont faibles, moins ils peuvent protéger les leurs. Cette pandémie nous donne donc matière à réfléchir sur le rôle de l’État, ses forces et ses faiblesses. On voit assez clairement que cela remet l’action publique et la maîtrise par l’État au centre, y compris sur des sujets comme la maîtrise de nos propres productions, nos dépendances à d’autres économies, notre fragilité aussi par rapport à des États forts qui ne respectent pas toujours les libertés individuelles. C’est donc bien l’articulation entre un État puissant protecteur et un État garant des libertés individuelles qui est aujourd’hui au cœur des champs d’observation et de réflexion ouverts par la pandémie.
Les Français de l´étranger, qui appartiennent à la communauté nationale malgré leur éloignement géographique, sont soumis pour certains aspects aux lois françaises, mais parallèlement, pour d’autres aspects, ils dépendent des lois en vigueur dans leurs pays de résidence. Quels sont, selon vous, les principes à défendre, les valeurs universalistes communes à tous les progressistes ? Où se situe la ligne de crête entre l’ingérence dans les affaires internes d’un pays et la défense de nos valeurs ?
Les expatrié.e.s partout dans le monde (Français.e.s de l’étranger et étranger.e.s en France) ne sont pas supposé.e.s interférer dans les affaires politiques des pays dans lesquels ils et elles vivent. En même temps, s’agissant des Français.e.s, j’ai quand même souvent observé qu’ils/elles ne restent pas à l’écart des luttes progressistes, des combats pour les droits, pour l’émancipation, en particulier celle des femmes, menées dans les pays où ils résident ; dès lors que nos compatriotes ont construit des liens avec les ressortissant.e.s du pays dans lequel ils vivent, ils sont souvent crédités d’une présomption d’incarnation de ces valeurs progressistes. Ils sont aussi des points d’appui pour les pays qui luttent, pour les femmes en particulier, pour peu qu’ils acceptent de s’engager auprès des groupes porteurs de valeurs progressistes, humanistes et libérales, au sens non pas économique du terme, mais politique. Les Français peuvent être aidants. On bénéficie à l’étranger d’un préjugé favorable, parce qu’on vient du pays de la Déclaration des Droits de l’Homme et qu’on est supposé être engagé pour ces valeurs.
Par ailleurs, pour ma part, il y a des valeurs universelles : les droits humains sont universels et c’est comme ça que s’est construit une bonne partie de la seconde moitié du 20ème siècle, sur l’universalisme d’un certain nombre de valeurs humaines et contre leur relativisme. Pour donner une illustration pratique, en ce qui concerne les droits des femmes, il y a un sujet qui est abordé de manière récurrente à l’ONU. Tous les ans, quand le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) discute de la mise à jour de la Déclaration de la Conférence de Beijing, il y a un groupe de pays qui souhaite voir ajouter : « les droits des femmes sont universels, sous réserve des coutumes propres à chaque pays ». Ce « sous réserve des coutumes propres à chaque pays », qui est l’introduction du relativisme dans l’universalisme, vise justement à affaiblir les valeurs qui sont les nôtres : le droit de disposer de son corps, la lutte contre les mutilations génitales. Est-ce que l’excision est compatible avec le droit des femmes, sous réserve des coutumes propres à chaque pays ? Ma réponse est non.
Donc le relativisme orthogonal à l’universalisme est en fait le moyen d’abaisser les ambitions de celles et de ceux qui ont besoin d’un socle de valeurs universelles pour défendre leurs droits. L’universalisme est un point d’appui pour celles et ceux qui luttent pour leur émancipation. Si on affaiblit l’universalisme, on affaiblit celles et ceux qui luttent et, dans la vie, on ne peut pas être neutre, on ne peut pas tout le temps renvoyer les choses dos à dos. On peut et on doit choisir dans quel camp on se situe, celui de l’émancipation ou celui du conservatisme, celui de l‘émancipation ou de la domination. C’est l’universalisme qui donne de la force à toutes et à tous, contre le relativisme qui affaiblit celles et ceux qui luttent. Je ne mets pas sur le même plan celles et ceux qui luttent pour perpétrer les mécanismes de domination et celles et ceux qui luttent pour leur émancipation.
Entretien réalisé par Florence Baillon
Retrouvez le dernier numéro de notre magazine : FDM-203-Printemps-2021_pages.pdf