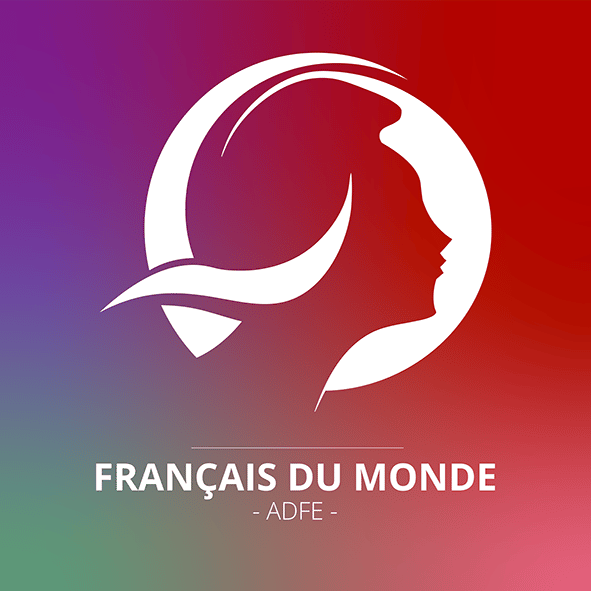Dans votre ouvrage « Faut-il donner un prix à la nature ? », vous évoquez le principe du pollueur/payeur, concept qui fait sens à la fois à l´échelle nationale mais également entre les pays. Pourriez-vous nous rappeler en quoi consiste cette idée, ses bénéfices et ses limites ?
Le principe du « pollueur-payeur » vise à faire supporter par les pollueurs eux-mêmes les coûts liés aux mesures de prévention, de réduction ou encore de réparation des différentes formes de pollution. Vous polluez, à vous de payer. L’idée est qu’à terme, le prix de la pollution soit si élevé qu’il dissuade les pollueurs de polluer. C’est notamment dans cet esprit et espoir que l’idée de « Prix carbone » a vu le jour.
Ce principe est souvent présenté comme l’outil le plus efficace afin de pousser les agents économiques au changement. Il est pourtant éminemment contestable, et ce, sous au moins deux aspects.
Tout d’abord, on sait que le signal prix, à savoir le fait de donner un prix à une action – en l’occurrence, polluer – n’a de sens que si le renchérissement du coût de cette action devient effectivement pénalisant pour les acteurs touchés. En clair, le fait d’associer un prix bas au fait de polluer n’aura absolument aucune incidence sur leur action.
C’est d’ailleurs ce qui s’est passé au niveau européen avec la mise en œuvre en 2005 d’un « marché carbone », aussi appelé « système d’échange de quotas d’émissions », qui devait permettre une réduction des émissions de gaz à effet de serre conformément aux engagements politiques pris en la matière.
Or si l’objectif de ces marchés est en principe de faire payer plus cher la pollution afin de la réduire in fine, on peut dire que c’est le contraire qui s’est passé en Europe avec les marchés carbone : les quotas ont été « suralloués », c’est-à-dire, donnés dans des quantités beaucoup trop importantes, pour ne pas déplaire aux lobbies industriels et énergétiques, et ce système a permis de très nombreuses fraudes ou fuites. Au final, le prix du carbone s’est effondré : la tonne de C02 européen est passée de 30€ à 5€ entre 2005 et 2014. Un prix tellement bas que les industriels n’avaient plus qu’à acheter ces quotas bradés pour polluer plus en toute impunité.
La deuxième objection principale que l’on peut opposer au principe du pollueur-payeur est que, pour qu’il soit efficace, encore faut-il qu’il existe une alternative possible. Il ne suffit pas de renchérir le prix d’une action pour que les acteurs s’en détournent. C’est d’ailleurs ce que l’on a vu avec le mouvement des Gilets jaunes. Ainsi, nombre d’entre eux ne manifestaient pas seulement contre une hausse du prix du diesel mais, plus largement, contre un modèle dont ils se retrouvaient prisonniers : après avoir été incités pendant des années à acheter des véhicules diesel, leur usage se retrouvait taxé, sans que des modes alternatifs de transport ne soient disponibles.
En réalité, il faut avoir le courage de dire que le signal prix ou encore le principe pollueur-payeur est loin d’être la panacée pour atteindre nos objectifs en matière de réduction des gaz à effet de serre. Le plus efficace reste la réglementation, et c’est d’ailleurs ce que à quoi nous avons pu assister avec le fameux « trou » dans la couche d’ozone, qui a été résolu non pas par une taxe, mais par un accord international. En effet, le protocole de Montréal a permis, en interdisant la production, la commercialisation et l’utilisation d’un certain nombre de substances chimiques, de régler le problème. En une vingtaine d’années, ces produits chimiques ont officiellement disparu et le trou s’est presque intégralement rebouché. Voici un exemple de réglementation efficace pour faire face à un problème de pollution à l’échelle planétaire.
Plus généralement, le principe du pollueur-payeur s’intègre dans un cadre idéologique selon lequel il suffirait de fixer un prix pour régler un problème. Ce cadre de pensée, ce réflexe intellectuel est particulièrement répandu chez les économistes dits mainstream, pour lesquels il n’y a pas de problème qui ne puisse être réglé par un prix. En d’autres termes, à chaque fois qu’un problème surgit, c’est parce que les agents économiques sont perdus sans prix. Il faut donc à chaque problème créer les conditions d’émergence d’un marché…
Bien sûr, c’est une vue de l’esprit : on se rend compte, dans les faits, que la réglementation, l’éducation et l’investissement sont des méthodes bien plus efficaces que la simple instauration d’un signal prix. Mais cela demande aux gouvernements de prendre leurs responsabilités et d’intervenir pour fixer un cadre et le faire respecter.
Pour résumer : on utilise à la fois trop peu la taxation environnementale tout en lui en demandant beaucoup trop. La taxation ne peut et ne doit être qu’un élément parmi d’autres, mais ne saurait constituer une panacée quelconque en matière de politique publique, pour la simple et bonne raison que, quand on taxe la pollution, on ne la limite pas. Ce sont donc deux outils qui peuvent être complémentaires, mais qui ne sont en aucun cas substituables.
L’environnement est l´un des sujets sur lesquels vous travaillez depuis longtemps, quelle est selon vous, la politique qui permettrait de le préserver sans entraîner une dégradation sociale, voire en améliorant les conditions de vie de la population ?
La question du lien entre écologie et politique sociale est absolument centrale. En effet, comment envisager une transition écologique qui ne s’intéresse pas au sort des plus fragiles et continue d’accroître les inégalités ?
C’est la raison pour laquelle les enjeux environnementaux ne peuvent être traités seuls, à côté des questions économiques et sociales. Ils nécessitent au contraire de repenser intégralement notre modèle économique et de développement. De la même manière, on ne pourra remporter le pari de la transition écologique sans s’attacher à résoudre, dans le même mouvement, la question des inégalités économiques et sociales.
En effet, les inégalités économiques sont à l’origine d’inégalités environnementales qui se traduisent très concrètement dans le quotidien des personnes concernées. Ce sont ainsi les plus pauvres qui habitent près des zones à risque en matière environnementale, les fameuses « zones Seveso », par exemple. Les plus pauvres qui ne disposent pas des moyens nécessaires pour rénover leur habitation subissent la double peine d’une maison impossible à chauffer et de factures d’énergie très élevées.
Mais cette inégalité face aux enjeux environnementaux ne s’arrête pas là. En effet, ce sont non seulement les riches qui polluent le plus et subissent le moins les effets des pollutions, mais ce sont eux, encore, qui contribuent le moins à la transition écologique. Selon une étude menée par Lucas Chancel et Thomas Piketty, les 1% les plus riches au niveau mondial polluent individuellement 2 000 à 3 000 fois plus que les 10 % les plus pauvres. Malgré cela, la hausse de la taxe carbone prévue en France aurait affecté en priorité les ménages les plus précaires : 4 à 5 fois plus, selon les auteurs ; Ceci d’autant plus que cette taxe aurait touché de plein fouet ceux qui n’avaient d’autre solution que de prendre leur voiture pour se déplacer et de se chauffer avec les hydrocarbures. Dès lors, plus les revenus sont faibles, plus ces dépenses contraintes entament le pouvoir d’achat des ménages.
On voit donc que la question environnementale et la question sociale sont intimement liées. Toutefois, se battre contre le réchauffement climatique et l’effondrement du vivant, ce n’est pas seulement un moyen d’améliorer les conditions de vie, c’est aussi et peut être surtout un impératif afin d’éviter un effondrement de ces conditions de vie. C’est une nécessité si nous voulons continuer d’habiter une planète vivable, pour les plus pauvres mais aussi pour les plus riches.
C’est pourquoi le « Green New Deal » que je porte au Parlement européen ne se limite pas à un plan d’investissement dans les énergies renouvelables. Ce doit être un grand projet de transformation écologique, économique et sociale de notre société, qui prône non seulement une remise à plat de nos indicateurs de richesse afin de guider au mieux l’action politique, mais ambitionne également d’offrir des solutions concrètes sur des sujets aussi variés que l’emploi, la réindustrialisation ou encore la justice fiscale.
Vous avez participé activement à la création et au développement du « Green New Deal », pensez-vous que peser sur les politiques publiques à travers les institutions est la voie pour un changement réel ?
Je pense effectivement que vient un moment où la conquête des institutions devient nécessaire pour la mise en œuvre de ses idées. J’ai été en charge, pendant plusieurs années, d’un institut de recherche qui m’a permis de travailler à la diffusion d’idées nouvelles sur les questions économiques et de transition écologique. Puis j’ai décidé de passer le pas et de me présenter aux élections européennes dans l’espoir de pouvoir agir concrètement à la mise en œuvre de ces politiques que je porte depuis des années.
Se battre de l’extérieur, sans participer à la mécanique politique et institutionnelle, cela s’appelle du lobbying ou de la communication. Ce sont d’ailleurs deux modes d’action tout à fait utiles et louables, mais je pense que si l’on veut accélérer le changement vers des politiques véritablement écologiques et sociales, il est nécessaire – à un moment – de s’engager soi-même et de se servir des moyens concrets qui existent.
Vous êtes élue au Parlement européen et vous avez toujours travaillé en collaboration avec des personnalités et des élus d’autres pays européens ; qu’apporte cet espace multilatéral qui n´existe pas ailleurs ?
J’ai toujours beaucoup travaillé avec des intellectuels et des chercheurs européens. J’ai ainsi écrit un livre avec l’économiste britannique Tim Jackson, spécialiste de la prospérité sans croissance, et travaillé en étroite collaboration avec l’économiste et ancien ministre des finances grec Yanis Varoufakis, afin d’élaborer les principes d’un « Green New Deal européen ».
Je suis également avec intérêt les travaux d’Américains tels que James Galbraith, auteur de « L’État prédateur », et avec lequel nous avons travaillé sur la question du néolibéralisme et de la prédation du bien commun par les intérêts privés.
Il est toujours intéressant de travailler et d’échanger avec des intellectuels et des personnalités engagés d’autres pays, non seulement parce que cela permet de se rendre compte des différences d’approche et de sortir d’une vision parfois légèrement franco-française des sujets. Surtout, cela permet de se rendre compte qu’au-delà des différences méthodologiques et d’approches naturelles, notamment avec les pays anglo-saxons, on retrouve des intérêts et des volontés partagées.
Les instances européennes semblent éloignées de la vie quotidienne des habitants, et c’est peut-être encore plus vrai pour les Français de l´étranger vivant hors d’Europe. Que faudrait-il envisager pour que la citoyenneté européenne s’incarne davantage ?
Le fait que les institutions européennes souffrent d’une image technocratique et lointaine est en partie justifié, mais en partie seulement. On peut en effet s’accorder sur le fait que le projet européen est loin d’être abouti et que le travail d’instances comme la Commission ou même le Parlement européen reste, pour beaucoup de citoyens, assez abstrait. Il y a aussi un problème inhérent au mode de fonctionnement de l’Union et à son processus de prise de décision : pour ma part, je suis favorable à un véritable saut fédéral et à un gouvernement européen démocratiquement élu.
Pour le reste, je pense que l’Union européenne sert bien souvent de bouc émissaire et d’excuse aux gouvernements nationaux pour justifier la mise en œuvre de politiques antisociales. Par paresse intellectuelle, l’Europe est aujourd’hui accusée de tous les maux. À chaque problème, il est facile de s’exonérer de ses responsabilités et de déclarer que « c’est la faute à l’Europe ». Or les insuffisances et les blocages de l’Union européenne sont bien plus idéologiques et politiques qu’institutionnels.
Il faut dire que l’Union fonctionne avant tout sur le principe de l’intergouvernementalité : ainsi ce sont les chefs d’États et de gouvernements, réunis au Conseil, qui fixent les grandes orientations de la construction européenne. Or, les institutions européennes sont souvent plus réactives et progressistes que les majorités au pouvoir dans les différents États membres. Ainsi, lors de la première vague de la Covid-19, les États membres ont été incapables de se mettre d’accord pendant de longues semaines alors qu’une institution purement européenne comme la BCE a pu agir avec la célérité et l’efficacité nécessaires pour sauver les économies de la zone euro.
C’est bien la preuve que les blocages sont avant tout politiques et idéologiques et que si nous voulons que les choses changent au niveau européen, il faut avant tout se battre sur ce terrain pour changer les choses.
En revanche, je pense qu’on ne comblera pas le fossé qui s’est créé entre les institutions européennes et les citoyens en se contentant de mettre en avant les actions concrètes – nombreuses au demeurant ! – de l’Union européenne au quotidien. Pour moi, il est clair que si l’Union doit retrouver cette capacité d’attraction qu’elle a eu pendant des décennies, elle doit être capable d’agir concrètement au service des Européens. En clair, il faut que l’Union européenne nous fasse du bien.
Cela passe, bien évidemment, par des actions importantes et de long terme comme la lutte contre le dérèglement climatique ou la protection de la biodiversité, mais aussi par des engagements concrets au service des plus fragiles et contre les inégalités. C’est la raison pour laquelle je porte au Parlement européen l’idée d’une Garantie européenne de l’emploi qui permettrait de fournir à tous les chômeurs de longue durée un emploi décent dans le secteur de la transition écologique.
Enfin, je pense que la construction et la cohésion européennes doivent passer par des symboles, des moments qui nous rappellent notre appartenance commune à l’Union européenne. En l’espèce, l’instauration d’un jour férié européen – qui remplacerait, pourquoi pas, nos jours fériés respectifs commémorant des victoires militaires – pourrait rappeler à tous les citoyens européens qu’ils font partie de ce beau projet qu’est l’Europe. Un chemin certes difficile et ambitieux, mais qui semble plus nécessaire que jamais au vu des grands défis du XXIe siècle.
Propos recueillis par Florence Baillon