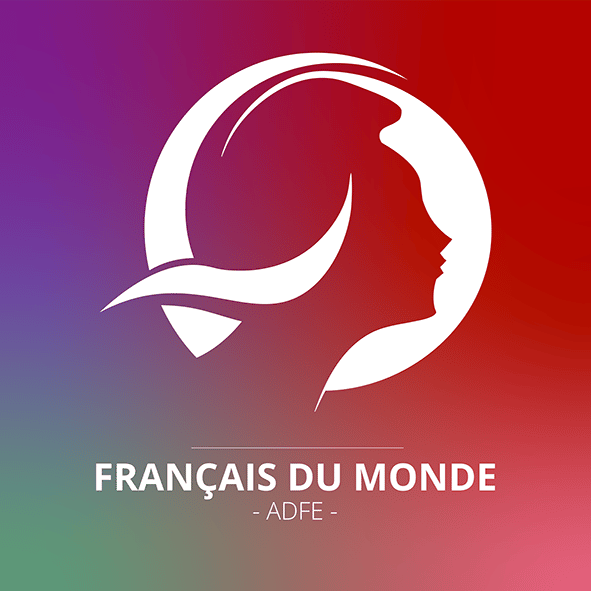Agnès Van Zanten est directrice de recherche au CNRS, à Sciences Po et à l’EHESS et spécialiste des questions d’éducation.
Depuis les Trente Glorieuses, l’enseignement a connu en France un double phénomène de massification et de démocratisation. Peut-on dire qu’avec l’avènement de l’école de masse, le système scolaire soit devenu plus démocratique ?
Le sociologue utilise le terme de massification pour faire la différence entre ce qui serait une démocratisation au sens fort du terme et ce qu’on appelle une massification qui correspond plutôt à un accès élargi des jeunes de tous milieux sociaux à des scolarités plus longues avec l’idée que cet allongement se fait surtout au profit des catégories les plus défavorisées. On attendait de cette expansion de l’enseignement qu’elle engendre une véritable démocratisation mais on a été confronté à deux nouveaux problèmes : l’échec scolaire et la ségrégation scolaire.
Concernant l’échec scolaire, on a longtemps cru que mélanger les élèves dans un même établissement allait conduire au même degré de réussite pour tous sans qu’il y ait besoin de faire évoluer les méthodes d’enseignement. Or cela n’a pas été le cas et un problème jusque-là individuel est devenu un problème social. Le terme d’échec scolaire apparaît alors dans les années 60.
La ségrégation scolaire est en partie la conséquence des réponses qu’on a apportées pour lutter contre l’échec scolaire. On a en effet proposé des classes spéciales pour les jeunes en difficulté et ce système a opéré une très forte ségrégation interne au collège et au lycée. S’y sont ajoutées des options comme les classes européennes, à horaires aménagés en musique ou arts plastiques, bilangues etc destinés à retenir et à attirer les jeunes en situation de réussite qui renforcent encore davantage la ségrégation entre les classes, à laquelle s’ajoute une ségrégation importante entre les établissements. C’est pourquoi les sociologues utilisent d’avantage le terme de massification ou de démocratisation ségrégative.
Dès le début des années 1980, les pouvoirs publics ont pris diverses mesures afin de favoriser l’égalité des chances : il s’agit essentiellement des différents dispositifs relatifs à l’éducation prioritaire destinée aux populations les plus défavorisées. Puis, au début des années 2000, des établissements d’enseignement supérieur (Sciences Po, ESSEC, classes prépas du lycée Henri IV) ont adopté des politiques d’ouverture sociale. Que pensez-vous de ces mesures et de ces initiatives ? Sont-elles efficaces ?
Tout dépend de l’objectif qu’on leur assigne. J’ai étudié plusieurs de ces dispositifs. Le terme d’égalité des chances n’est pas anodin. Dans les années 80, on s’est un peu orienté vers une égalité des résultats avec la mise en place des zones d’éducation prioritaire. A la fin des années 90, on a eu l’impression que ces politiques n’avaient pas porté leurs fruits, ce qui est en partie vrai et en partie faux. Les ressources données n’étaient pas en tout cas les mieux adaptées pour réduire les écarts de réussite entre les enfants. A la fin des années 90, début des années 2000, émergent donc ces nouvelles politiques d’ouverture sociale et différentes grandes écoles comme Sciences Po mettent en place des parcours d’excellence pour des jeunes issus de milieux et d’établissements défavorisés. Ces dispositifs ne peuvent pas être conçus comme faisant partie des politiques de lutte contre les inégalités. Ce sont des actions destinées à renouveler les élites, ce qui est souhaitable car il est important que la population puisse se reconnaître dans ses élites. Mais ces politiques ne s’adressent qu’à un tout petit nombre et ne peuvent donc s’attaquer aux inégalités de masse. La confusion entre ces deux objectifs est entretenue par le fait qu’en France, la vision dominante, très portée par le corps enseignant et par l’ensemble de la nation, est que l’égalité, c’est amener les élèves le plus loin possible dans le système d’enseignement vers les filières d’excellence. Mais un tel parcours n’est pas possible pour tout le monde. L’égalité, ce n’est pas que tous les enfants fassent Polytechnique, qui n’a pas augmenté son nombre de places depuis deux siècles. L’égalité réelle, c’est que tous les enfants acquièrent le niveau d’éducation nécessaire pour être des citoyens français du XXIème siècle à part entière.
De quels exemples étrangers pourrions-nous nous inspirer ?
C’est toujours très compliqué de s’inspirer des exemples étrangers car il est difficile d’isoler tel ou tel élément du contexte dans lequel il est encastré. Il y a des pays, comme les pays nordiques, la Finlande notamment, dans lesquels les inégalités sont faibles. Ils ont des politiques structurelles comme le fait de garder tous les enfants ensemble jusqu’à l’âge de 18 ans ou de limiter les différences entre établissements en termes d’offre pédagogique et de public.
Certaines pédagogies sont aussi plus efficaces, notamment l’individualisation, mais au sein de la classe, contrairement au modèle français qui consiste à sortir l’élève de la classe dès qu’il y a des problèmes pour des dispositifs d’aide et de soutien qui deviennent malheureusement des dispositifs de relégation. Mais ces conditions sont plus faciles à réunir dans des pays comme la Finlande où il y a beaucoup moins d’immigrés, où la société est beaucoup plus égalitaire sur le plan économique, où la ségrégation urbaine est beaucoup plus faible.
Quand on se penche sur des sociétés plus comparables à la France, par exemple l’Angleterre dont les résultats se sont améliorés dans les derniers résultats PISA, on observe que certaines politiques peuvent être efficaces dès lors qu’elles s’accompagnent d’un monitoring étroit des établissements. Or en France on a un gros déficit de suivi, on lance des tas de politiques mais le premier problème reste de savoir si elles ont été appliquées et comment, avant même de pouvoir les évaluer. Actuellement, nous sommes dans un contexte où on ne sait pas trop ce qui a marché ou pas marché parmi les politiques des décennies précédentes et on lance d’autres politiques censées réparer on ne sait pas vraiment quoi.
Le gouvernement a lancé une ambitieuse réforme du collège qui doit entrer en vigueur en septembre 2016. Pensez-vous que les dispositions de cette réforme, amplement commentée, et souvent critiquée, y compris par des enseignants, soient pertinentes et permettent de réparer un collège en panne ?
Au départ il y a des bonnes idées. Il y a eu un effort pour réfléchir autour de la diminution des options, pour dire que la pédagogie doit changer, pour davantage de travail en équipe. Le problème ensuite est de savoir ce que deviennent ces réformes au bout des négociations qui ont lieu avec les différents acteurs, quels moyens sont accordés pour leur mise en place et de quels dispositifs on se dote pour les accompagner.
Une des idées fortes portées par cette réforme est que l’interdisciplinarité va réduire l’échec scolaire. Or il faut se pencher sur ce qu’on entend par interdisciplinarité. En fait, on veut plutôt dire travail en équipe entre enseignants et il faudrait préciser comment le mettre en place et dans quel but. Concernant les options, on a voulu avoir une politique assez symbolique autour de leur réduction mais il aurait fallu très clairement indiquer que ce ne sont pas les options en soi qui sont problématiques, c’est le fait qu’elles soient liées à des pratiques de sélection interne car de nombreux établissements les utilisent pour créer des classes de niveaux.
Vos derniers travaux portent sur l’orientation post bac des jeunes, notamment sur l’accès à l’information dont ils disposent pour les guider dans leurs choix. Quel état des lieux pouvez-vous en faire ? Comment remédier aux éventuelles inégalités ?
Nous venons justement de récolter les données d’enquête de 4 établissements en région parisienne, 3 établissements publics de niveaux différents et 1 établissement privé. Ce qui apparaît très clairement, sans être une surprise, est que les orientations proposées dépendent fortement des caractéristiques scolaires et sociales des élèves. Dans le lycée très favorisé, on ne parle quasiment que des classes préparatoires. A contrario, dans le lycée très populaire, on ne parle que des BTS et de l’université.
Nous nous sommes aussi intéressés à l’attention portée aux élèves et deux différences importantes émergent : le moment auquel on parle de l’orientation et la nature de l’information transmise aux élèves. Dans le lycée très favorisé, on en parle dès la seconde voire même avant la seconde. Dans les lycées moyen et défavorisé, les élèves n’entendent parler d’orientation qu’au moment de l’ouverture de la plate-forme APB. Dans le privé et l’établissement public très sélectif, les conseils sont très personnalisés. En revanche, plus on va vers les établissements moins favorisés, moins l’accompagnement est personnalisé et plus il devient bureaucratique. On se soucie alors surtout de rappeler le fonctionnement d’APB et de s’assurer que les élèves émettent au moins un vœu dans le système.
Je me suis aussi beaucoup intéressée aux salons de l’éducation. Nous avons observé quinze salons en Région parisienne et nous avons pu constater que beaucoup de jeunes des classes moyennes et populaires vont à ces salons dans lesquels il y a une autre représentation de l’enseignement supérieur car il y a beaucoup d’établissements privés commerciaux et pas d’établissement haut de gamme. Il existe donc un risque pour les jeunes qui vont à ces salons de se laisser attirer par des établissements coûteux qui offrent des formations souvent non reconnues l’Etat et peu valorisées par les employeurs.
Par ailleurs, ce qui m’intéresse sur un plan plus qualitatif, c’est de savoir comment fonctionne APB. APB se veut démocratisant parce qu’il offre beaucoup d’informations et incite fortement à faire plusieurs choix, mais d’un point de vue sociologique, on sait que cela peut permettre d’élever les aspirations mais pas forcément de construire des vœux de façon stratégique avec des chances d’être accepté. Les inégalités d’accès à l’information sont remplacées par des inégalités d’usage de l’information. Est-ce qu’on sait se servir de l’information ? Mais aussi, est-ce qu’on a le niveau pour accéder à ses vœux ?
Ce processus d’orientation est-il spécifique à la France ? Existe-t-il des pays « modèles » en matière d’orientation post-bac ?
Dans les pays où il y a une meilleure orientation post-bac, les pays nordiques encore une fois, c’est souvent dû au fait qu’il n’y ait qu’un seul type d’enseignement supérieur, un diplôme d’une université ou d’une autre ne fait pas vraiment la différence. En France, il y a le caractère dual Grandes écoles et université. Il faudrait déjà renforcer les passerelles entre les deux systèmes mais de façon moins malthusienne qu’aujourd’hui. Par ailleurs, pour les jeunes de milieux populaires, ce n’est pas nécessairement une bonne idée de leur proposer d’emblée des formations en 5 ans car ils ne savent pas s’ils auront la possibilité, notamment financière, d’aller jusqu’au bout. Idéalement, il faudrait donc pouvoir leur proposer des parcours en 2 ou 3 ans avec sortie sur le marché de travail et la possibilité de continuer, voire de revenir après une période de travail sans être pénalisés dans l’accès à des cursus longs. Par ailleurs, l’accueil dans les institutions pour l’aide à la réorientation des jeunes qui veulent changer de parcours demeure très limité.
Les jeunes sont de plus en plus incités à poursuivre leurs études à l’étranger. Sur quels atouts notre enseignement supérieur peut-il s’appuyer pour résister à cette pression concurrentielle ?
Nous constatons que l’atout Grandes écoles françaises reste encore très important sur le marché de l’emploi national. Pour les catégories sociales qui pourraient envoyer leurs enfants faire leurs études à l’étranger, la stratégie est de leur faire faire d’abord des études en France qui seront ensuite complétées par un MBA dans un autre pays pour gagner sur les deux bords : avoir des réseaux dans les Grandes écoles et dans l’Etat français et avoir une dimension internationale.
Par ailleurs, en comparant les jeunes fraîchement diplômés d’Oxford et de Sciences Po, il apparaît que les jeunes Français ne se projettent pas dans une vie à l’étranger. Ils parlent souvent de revenir même si la réalité pourrait être autre. Il y a aussi une croyance dans la dimension généraliste de l’enseignement d’élite français, dans un modèle culturel qui est indissociablement intellectuel et social et qui donne toutes les garanties qu’on peut faire confiance à ceux qui ont été formés dans ce cadre. Ainsi, une autre étude conduite sous ma direction montre que les étudiants français restent très méfiants vis-à-vis des étudiants étrangers qui arrivent dans les grandes écoles sous prétexte que n’ayant pas intégré ces établissements par la voie du concours, ils ne seraient pas aussi légitimes, aussi bons qu’eux. C’est heureusement une vision qui est en train d’évoluer.